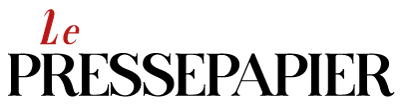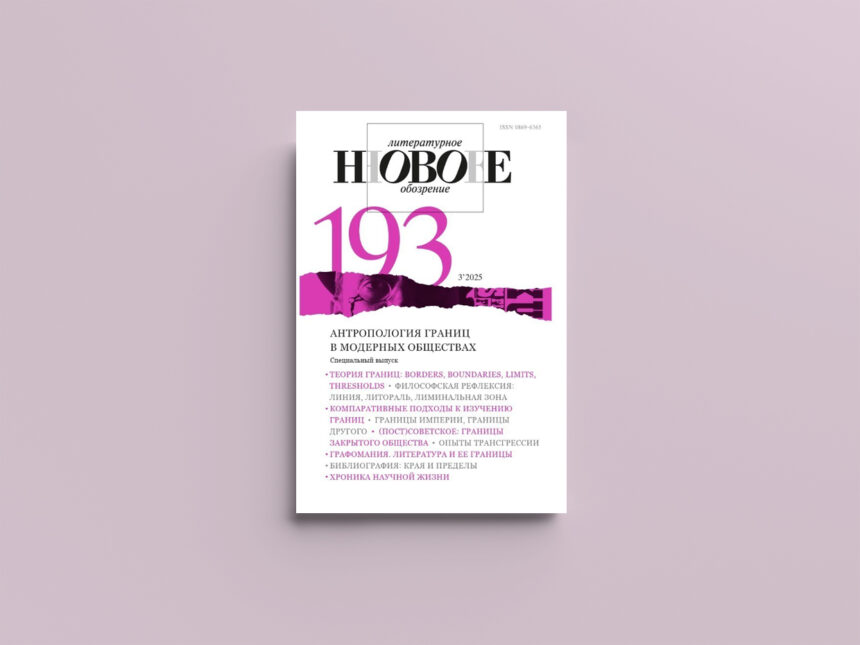En russe le mot pour «frontière», Granitsaporte une gamme de significations qui brouillent sa définition en tant que ligne de démarcation territoriale et administrative. Ils incluent la limite, la frontière, la limite, la marge, la limite, le seuil, le littoral et la frontière. La première syllabe, Gran ‘, Traduit par «bord», liens également Granitsa à un état d’être «au bord».
En tenant compte de ces associations, la revue basée à Moscou Novoe literaturnoe obozrenie 3/25 (New Literary Review) explore des idées sur les frontières et les frontières dans une variété de contextes: géographique, social, psychologique, historique, idéologique, philosophique et esthétique.
Effacer les limites
Staline dirigé par les nombreuses cartes affichées dans son bureau, observe Evegeny Dobrenko (CA ‘Foscari University of Venise) dans un article sur la rhétorique de la parenté entre les peuples de l’URSS. La propagande a présenté le monde au-delà des frontières soviétiques comme hostiles et divisées par des inimities nationales, des langues inaccessibles et des codes de communication cassés. Dans l’espace soviétique, cependant, les frontières culturelles et territoriales ont été déclarées effacées. En même temps, la ligne de division sociale entre le nomenclature (classe dirigeante) et le reste de la société soviétique a été camouflé.
Alors que le régime de Staline cherchait à mettre en œuvre une marque de socialisme exclusivement soviétique, elle a reconditionné la notion marxiste de la confrérie du prolétariat à des fins domestiques. Il y avait environ 130 langues différentes en URSS, mais l’arc-en-ciel de l’amitié « unissant ses peuples transcenderait les barrières de communication. Le territoire soviétique a été traité comme «un seul espace acoustique» qui pourrait absorber les variations linguistiques entre les nationalités prétendument unies par une expérience partagée et un engagement idéologique.
Les mots partagés étaient considérés comme la voie de l’homogénéité. Les paeans à un «super-langage» qui essuieraient les différences linguistiques devenaient dominants dans la poésie dans toute l’URSS, parallèlement à «la balise immortelle du camarade Staline» et à la «compassion universelle du peuple russe».
La fusion de la propagande et de la littérature a culminé pendant la Seconde Guerre mondiale alors que les frontières extérieures du pays ont perdu leur stabilité précédente. Toute individualisation nationale ou ethnique a été interprétée comme une dissidence. Le poème du poète ukrainien Volodymyr Sosyura «Love Ukraine» (1944), traduit en russe en 1951, a enragé la presse à Moscou. Sosyura a été accusé d’avoir créé une frontière où aucun ne devrait exister.
« L’essence du nationalisme réside dans l’aspiration à se démarquer et à se pencher dans sa propre coquille nationale, dans l’aspiration à voir que ce qui divise », a écrit Pravda. L’Union des écrivains ukrainiens a été contraint de publier une réponse immédiate déclarant qu’avec l’attention et l’amour, nous continuons à apprendre le grand art de la littérature… des écrivains russes.
«La rhétorique de l’amitié a été utilisée pour cacher les pratiques impériales classiques», conclut Dobrenko. « Bien que la poésie soviétique ait insisté sur le fait que« l’amitié des peuples ne connaît pas de frontières », lorsque les nouvelles nations ont augmenté sur les ruines de l’Empire soviétique, les frontières sont apparues et ont mis fin à l’amitié.
Métaphysique de l’huile
Le message idéologique qui imprégnait et contenait la société soviétique a créé un fossé entre son univers imaginaire et le monde dans lequel les gens vivaient et travaillaient. Dans un article sur les effets culturels et économiques internes de l’industrie pétrolière soviétique, Ilya Kalinin (chercheur invité à l’Université de Humbolt, Berlin) écrit que la stabilité apparente des années entre la fin du Khrushchev dégel en 1964 et volume À la fin des années 80, «a caché une dynamique qui érodait le fondement même de l’ordre soviétique».
Les ressources pétrolières sibériennes ont gardé l’Union soviétique à flot, mais n’ont pas fait grand-chose pour servir sa population. Le pétrole, découvert à l’origine dans les années 1950 et 60, a été principalement vendu à l’étranger et utilisé par la direction soviétique pour conserver un système de vieillissement lourde et caché et cacher des échecs techniques, une mauvaise production, une distribution inadéquate et une mauvaise gestion. «La dépendance de la superstructure soviétique à l’égard du pétrole était trop importante pour être reconnue. Par conséquent, l’huile extraction a été présenté comme productioncachant la vérité sur l’industrie… à mesure que la dépendance économique à l’égard du pétrole s’est développée, un plus grand effort a été mis dans son déni par le récit économique et politique officiel.
Les propriétés et le potentiel des réserves d’huile inexploitées – fluidité, énergie potentielle et une capacité étonnante de transformation – leur ont conféré «un lien magique avec la richesse et les qualités transfrontalières du monde contemporain», suggère Kalinin. Comme les faits sur l’industrie étaient de plus en plus réprimés, l’huile est devenue culturellement mythologue. Il figurait comme un thème de la poésie et, notamment, dans le film épique acclamé d’Andrei Konchalovsky Sibérie (1979). Ici, l’image pétrolière «tourne les fibres de l’histoire, reliant ses marches narratives brisées» sur la toile de fond de l’espace sibérien et de son histoire coloniale supprimée.
Les vastes limites de la région, mais finalement pénétrables de la région, se révèlent moins horizontales que verticales. Ils se trouvent dans des couches géologiques où les limites du temps sont dépassées. Derrer, c’est creuser dans le passé, mais il s’agit également de libérer des réserves cachées de trésors liquides, se manifester comme des piliers de feu atteignant le cosmos.
Les années 1970 ont été marquées par des signes de retour en arrière du modèle communiste: un plus grand intérêt pour l’éthique des consommateurs, l’identité nationale, la religion, la tradition folklorique et la spiritualité du nouvel âge. À la fin de la décennie, Konchalovsky a été autorisé à libérer une épopée avec des dimensions ouvertement métaphysiques, représentant «une transgression des limites normatives de la culture soviétique». Mélanger documentaire avec le cinéma artistique, Sibérie combine un style réaliste socialiste avec la tradition déplacée de l’Avantgarde russe. Le conflit de classe est vu à travers l’optique des forces élémentaires et une recherche des origines de l’univers. Les identités sociales se dissolvent à mesure que les origines humaines partagées sont reconnues.
«La recherche de l’huile devient une recherche de sens», explique Kalinin. «L’économie politique pénètre dans l’ontologie… un récit sur la production se transgresse en une histoire sur la manifestation du sacré.» L’huile se connecte. Il devient l’image d’un principe qui déplace la nature et la matière, un « opérateur magique catalysant les transitions entre les quatre éléments… le lien final dans les processus chimiques et symboliques de transmutation qui absorbent et transfigurent la matière organique du passé antique, et la mémoire collective qu’elle tient ».
Discipline et délinquance
Dans le contexte culturel soviétique, la frontière entre «l’acceptable et l’inacceptable, l’établissement et le métro, était constamment en flux», écrit Mark Lipovetsky (Columbia University). Les conséquences de la traversée d’une frontière idéologique n’ont jamais été prévisibles. Entre 1955 et 1961, Andrei Sinyavsky (pseudonyme Abram Tertz) a écrit une série d’histoires satiriques qui lui ont valu une peine de sept ans de prison. Son procès fermé en 1966 – tenu aux côtés de celui de son collègue dissident, Yuli Daniel – se serait concentré sur le chevauchement entre les opinions de l’écrivain et celles de ses personnages.
Lipovetsky propose une comparaison entre Sinyavsky / Tertz Histoires fantastiques (Pantheon, 1963) et le travail du philosophe français Michel Foucault, qui a écrit un peu plus tard. Les similitudes résident en particulier dans leurs points de vue sur la paternité, le comportement «délinquant» et le panopticisme. Dans l’histoire de Sinyavsky, « Graphomaniacs » (1961), l’impulsion qui génère une culture souterraine de gribouillage obsessionnelle est comptabilisée aux limitations créatives imposées par le censeur soviétique. «Grâce à la censure… nous passons nos vies dans un paradis idiot», un «graphomane» dit dans l’histoire. «Nous nous flatons d’espoir… l’état (maudire!) Vous donne le droit de passer votre vie à vous imaginer comme un génie non reconnu.
Au sein de l’URSS, l’écriture était « la principale manifestation de l’agence », dit Lipovetsky, bien qu’elle ait également été «axée paradoxalement sur le retrait d’un auteur, qui a réalisé l’aspiration philosophique à dépasser sa propre existence et à passer à une dimension alternative (transcendantale)». Dans l’Union soviétique, la production de textes littéraires transgressives a été considérée comme une forme de «délinquance» sociale.
Sinyavsky dépeint la contrainte à écrire comme une libération d’énergie supprimée combinée à une envie d’éliminer le soi dans la création d’un texte. Foucault exprime une pensée similaire dans une conférence de 1969, faisant remarquer qu’un écrivain crée un espace dans lequel il disparaît constamment, jouant «le rôle d’un mort dans le jeu d’écriture». De même, pour Foucault, tout système disciplinaire incite l’envie de franchir ses limites. À un niveau systémique, le contrôle social externe pénètre dans la conscience individuelle et travaille pour imposer sa propre «vérité» à la personnalité. Le sentiment de surveillance internalisé qu’il provoque peut conduire à une réaction «délinquante».
Au sein du système soviétique, qui a cultivé une illusion d’omniscience panoptique, l’écrivain officiellement reconnu était un fonctionnaire central, tandis que le gribouillage non publié est devenu son « double délinquant ». Sinyavsky conçoit un auteur «radicalement impuissant mais libéré dans un espace liminal habité par les marginalisés et les exclus», écrit Lipovetsky.
L’histoire Pkhents (1957) démasque progressivement un narrateur qui apparaît successivement comme un bossu, une figure d’ethnicité mixte, comme homosexuelle, un migrant, un espion et finalement un extraterrestre. Le héros de Sinyavsky est exempt d’identité conventionnelle. Lorsque Pkhents se suicide, de peur de perdre son moi essentiel par l’assimilation dans la race humaine, il secoue les limites de la perspective standard et se perçoit de tous les côtés, tous les angles à la fois ». L’étranger représente le « prototype de l’auteur idéal » de Syniavsky, suggère Lipovetsky, «doté d’un don de désengagement absolu, qui est le fondement de la créativité littéraire».
Revue par Irena Maryniak