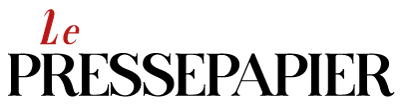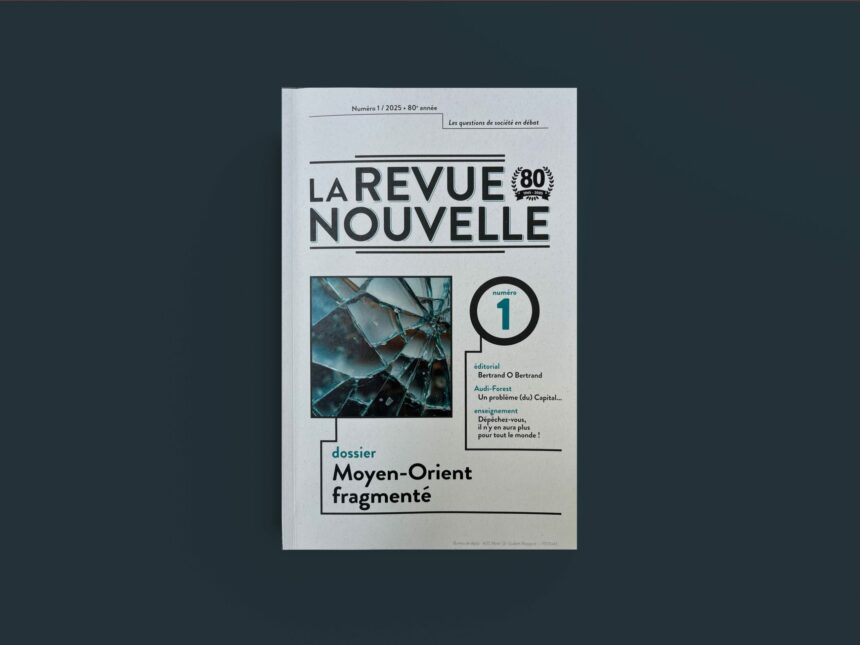Revue belge La Revue nouvelle offre un aperçu des conflits au Moyen-Orient. «La neutralité n’est ni possible ni souhaitable», dit le journal, mais nous pouvons essayer de «mieux comprendre le contexte qui a produit ces événements». Dans un dossier intitulé «Moyen-Orienent Fragmenté», le concours des contributeurs a accepté la sagesse et a fait la lumière sur la dynamique nationale et régionale.
Elena Aoun considère ce qui nous attend pour le Liban. Pendant une grande partie du monde occidental, écrit-elle, le Hezbollah est une «organisation terroriste» qui a entraîné le peuple libanais dans un conflit dévastateur avec Israël. Cette lecture a guidé la réponse des gouvernements occidentaux à la «guerre totale» d’Israël sur le Liban, le cessez-le-feu de 2024 et la redistribution du pouvoir politique dans le pays. Mais que se passe-t-il si ça n’allait pas?
Aoun examine les facteurs structurels qui ont produit et façonné le Hezbollah: l’expulsion d’Israël des Palestiniens et des attaques contre le sud du Liban; la marginalisation des communautés chiites; Interférence étrangère, menaces régionales et faiblesse de l’armée et de l’État libanais.
Aoun compare la réponse «prudente» du Hezbollah au lendemain du 7 octobre avec l’agression d’Israël. Même avant qu’Israël ne lance sa «guerre totale» en septembre 2024, il était responsable de 81% de toutes les frappes du conflit, avec «un taux de létalité 23 fois plus élevé» que celui du Hezbollah. Pourtant, l’accord de cessez-le-feu, qui est complété par un texte qui donne à Israël le «droit de réagir aux menaces» provenant du territoire libanais et de poursuivre ses survols du pays, apparaît désormais comme un « affaire de fou qui consolide la domination militaire américaine-israélienne du Moyen-Orient ».
Les perspectives d’Aoun sont pessimistes. Le pays du Liban doit «surmonter la polarisation et… paralyser les crises pour forger un contrat social avec toutes les composantes d’une population blessée et humiliée». Contrairement aux hypothèses, cela ne nécessite pas l’élimination du Hezbollah mais des solutions aux injustices qui le soutiennent.
L’Iran à un carrefour
Depuis le 7 octobre, le réseau régional soutenant le régime iranien s’est effondré et, avec lui, la légitimité qu’il a autrefois tirée de son prestige régional, écrit Jonathan Piron. Laissée sans zone tampon, le pays fait maintenant face à une stratégie agressive des États-Unis et au retour probable de la stratégie de «pression maximale» de Trump.
À la maison, «le contexte économique et social reste explosif»: l’inflation a grimpé en flèche et les citoyens ont du mal à accéder aux biens de base et au travail stable ». L’hiver dernier, une «crise énergétique inhabituellement intense a frappé tout le pays», révélant des problèmes profonds: « sous-investissement dans les infrastructures, aucune alternative énergétique au gaz, contrôle des ressources entre les mains du parastate et des institutions corrompues ». La population descend dans la rue, exigeant une réforme. Et avec la santé de l’ayatollah de 85 ans dans le doute, une crise de succession se profile. Dans ce contexte, quelles options restent ouvertes au régime?
Les modérés appellent la diplomatie à restaurer les relations avec les États-Unis et l’Europe. Mais les ultraconservateurs, « qui ont tellement investi dans le projet régional, voudront éviter d’être vu capituler ‘et essaieront plutôt d’exercer la puissance militaire de l’Iran. Ils essaient de reconstruire «l’axe de la résistance» à l’étranger ou de progresser »dans des investissements dans des armes conventionnelles, balistiques ou même nucléaires ».
Avocat
Depuis le 7 octobre, le droit international a été intimement invoqué par les analystes, les médias et les manifestants. De plus, les parties au conflit et à d’autres acteurs du gouvernement ont cherché à l’utiliser – quoique à des fins différentes. Cela suggère que, malgré les rapports contraires, le droit international est bien vivant, écrit Kheda Djanaralieva.
Israël et l’Iran ont tenté de légitimer leurs actions militaires à travers le droit de légitime défense consacrée dans la charte des Nations Unies. Bien qu’il ne s’applique que lorsqu’un état est l’objet d’une agression armée attribuable à Un autre état‘, Israël invoque le droit de justifier son assaut contre Gaza. L’Iran affirme que son attaque de missiles contre Israël en octobre 2024 était en état de légitime défense, en particulier en réponse à la frappe aérienne israélienne du consulat iranien à Damas. Pourtant, selon la Charte des Nations Unies, les États ne peuvent «utiliser la force que pour repousser une agression qui est en cours, et non punir celle qui a pris fin». Plutôt que de se soumettre au droit international, Israël et l’Iran cherchent à «l’instrumer pour servir leurs propres objectifs».
Pendant ce temps, des tiers s’engagent dans «Lawfare», c’est-à-dire en utilisant le droit international «pour modifier la trajectoire des hostilités en cours sans y participer directement». Le «conflit israélo-palestinien est depuis longtemps considéré comme la chose la plus proche que le monde a à un laboratoire de rédaction», où «les arguments juridiques remplacent les balles et les tribunaux remplacent les champs de bataille».
Ainsi, en 2023, l’Afrique du Sud a accusé Israël de génocide à la Cour internationale de justice, qui a ordonné à Israël de changer ses tactiques. Et en 2024, la Cour pénale internationale a publié des mandats d’arrêt contre trois membres du Hamas, Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant. Cela a rendu ces publics, apparemment «d’envoyer un message» et de transformer les mandats en «outils de dissuasion». Le droit international est en cours de mobilisation, Djanaralieva conclut – mais «il reste à voir si les parties au conflit le tiennent compte».
Revue par Cadenza Traductions académiques