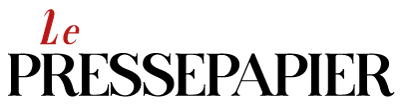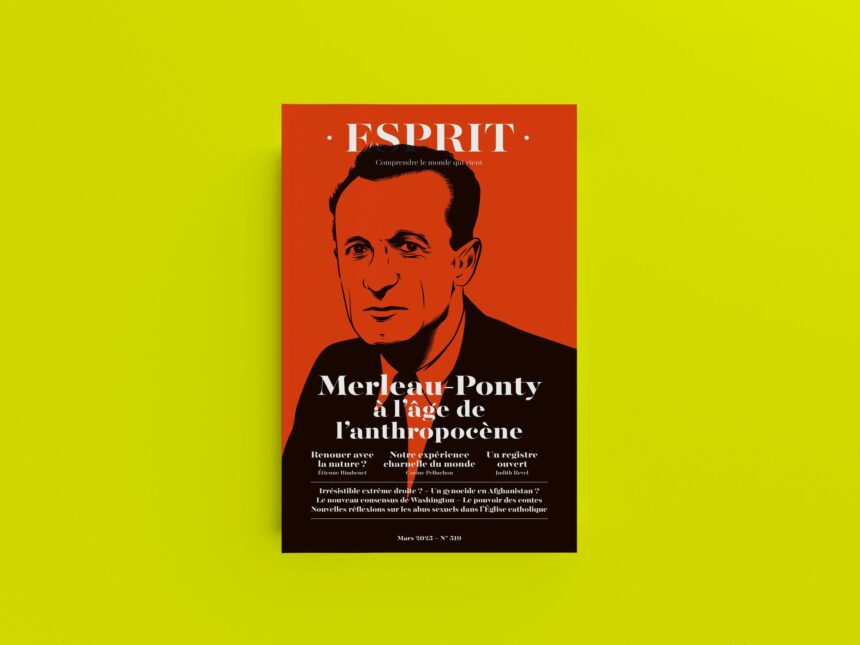La phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty a-t-elle quelque chose à offrir à une époque «d’instabilité démocratique, sociale, économique et environnementale»? Guillaume Le Blanc, rédacteur en chef d’un dossier d’Esprit 3/2025 sur le philosophe français du XXe siècle, croit qu’il le fait.
Dans la tradition philosophique qui s’étend de Nietzsche à Canguilhem, c’est la vie qui forme le sujet primordial de l’ontologie. Mais la vie a perdu ce rôle fondamental dans la philosophie contemporaine. Au lieu de cela, les philosophes soulignent maintenant comment les vies sont façonnées par les forces sociales, politiques et culturelles. Plutôt que de parler de la vie en général, nous parlons de la pluralité de la vie individuelle, chacune façonnée par son propre ensemble de conditions.
La revendication fondamentale de Merleau-Ponty est que le corps a traditionnellement, mais à tort, vu du point de vue de la troisième personne. Au lieu de cela, nous avons besoin d’un compte rendu à la première personne de ce qu’il est d’avoir un corps et de ce que c’est d’être un centre de perspective, entouré du monde. En d’autres termes, ce que Merleau-Ponty cherche à expliquer, c’est le fait de «l’incarnation».
Comment pouvons-nous adapter ce concept à de nouvelles idées sur les conditions qui façonnent la vie? Judith Butler a récemment fait valoir que Covid-19 a révélé la manière dont nos corps sont mélangés avec ceux des autres. Les corps sont poreux et perméables d’une manière qui rend impossible de les considérer comme souverain. Au lieu de cela, pour Butler, l’expérience fondamentale de l’incarnation est la relationnalité, et «le monde de la pandémie a révélé que les frontières de l’incarnation ne sont que provisoires».
En adaptant la pensée de Merleau-Ponty à cette nouvelle approche, ce qui émerge est un récit dans lequel différents corps ont des valeurs différentes, selon la façon dont elles sont reconnues et soutenues par différentes formes de pouvoir. De ce point de vue, écrit Le Blanc, être entièrement incarné est quelque chose à laquelle il faut aspirer et travailler, plutôt que quelque chose que nous pouvons tenir pour acquis.
Éco-phénoménologie
Lorsque la première vague d’éthique environnementale a émergé dans les années 1970, il a demandé comment nos lois et nos critères éthiques devaient être modifiés pour répondre aux préoccupations écologiques, écrit Corine Pelluchon.
Cela a été suivi d’une approche plus phénoménologique, avec des penseurs comme Kohák, Evernden et Toadvine faisant valoir que nous ne pouvons pas voir le monde naturel du troisième personnellement, comme un ensemble d’objets ou de ressources. Nous devons plutôt prendre une vision à la première personne: la crise environnementale est «une crise dans notre relation avec le monde», comme le dit Pellodon.
C’est pourquoi Merleau-Ponty et son récit de l’incarnation ont été si précieux pour ces penseurs. S’appuyant sur l’idée de Husserl du Environnement de vieMerleau-Ponty nous donne un moyen de comprendre comment notre environnement nous constitue, plutôt que d’être simplement quelque chose à maîtriser.
Mais Pelluchon tire également les limites de cette approche. L’éco-phénoménologie s’est trop concentrée sur notre lien avec la nature. Ce faisant, il n’a pas accordé suffisamment d’attention aux «formes pathologiques»: à l’éloignement que les humains peuvent ressentir de la nature ou de l’anxiété qui nous pousse à agir contre la nature et nos propres intérêts.
S’il peut également parler de ces choses, alors Pelluchon considère la phénoménologie comme offrant les ressources d’une nouvelle théorie politique, qui met l’accent sur le «caractère sublime de l’humain, notre capacité à nous dépasser, mais aussi à notre destructivité».
Effacer Merleau-Ponty
Dans la période entre sa mort prématurée en 1961 et dans les années 1990, Merleau-Ponty est en grande partie tombée hors de vue. Même de son vivant, il était souvent considéré comme «le finaliste éternel», en particulier en relation avec Sartre.
Judith Revel demande pourquoi c’était. Merleau-Ponty, soutient-elle, a été effacée de l’histoire philosophique en raison de son engagement avec le sujet de l’historicité. Elle se concentre particulièrement sur sa conférence inaugurale au Collège de France, où il présente le concept de «bonne ambiguïté». Cela fournit le cadre de toute sa pensée future.
Une bonne ambiguïté est une position qui embrasse l’ouverture et rejette la systématique. Il refuse toute sorte de déterminisme historique et embrasse «la complexité du monde» et «l’épaisseur de l’histoire». Avec cette insistance sur l’ouverture, Merleau-Ponty a rompu avec ses collègues, et c’est là que son effacement de l’histoire de la philosophie française a commencé.
Contes de fées
Les recherches de Nicole Belmont se concentrent sur les formules utilisées pour introduire des contes de fées alors qu’ils étaient principalement une tradition orale. Elle est particulièrement intéressée à utiliser les méthodes de psychanalyse pour explorer comment les contes de fées sont créés et dans les liens entre des histoires et des artisanat comme le tissage et la couture. À son avis, de telles histoires sont devenues plus faibles car elles sont devenues principalement des textes écrits, car «l’enfant n’a plus la liberté d’accueillir les images mentales que la voix humaine évoque».
Revue par Cadenza Traductions académiques