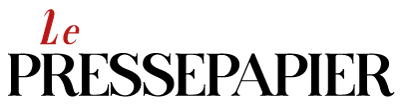Au cours des dernières semaines, Israël a marqué vingt ans depuis le «désengagement de Gaza»: l’opération de 2005 qui a déraciné 8 500 colons et a sorti ses troupes. Présenté comme un moyen de faciliter le fardeau militaire d’Israël et de redessiner ses frontières, le déménagement a contourné l’autorité palestinienne et a laissé Israël en contrôle des frontières, de l’espace aérien et des ressources de Gaza. À l’étranger, cependant, le retrait a été considéré comme un pas audacieux vers la solution à deux États. En tant que chef de la politique étrangère de l’UE à l’époque, Javier Solana l’a dit: «Le résultat réussi du désengagement offrira une étape importante pour un avenir pacifique pour les Israéliens et les Palestiniens, vivant côte à côte et jouit de la sécurité, de la prospérité économique et du bien-être social.» L’UE, aux côtés de ses collègues membres du quatuor – les États-Unis, la Russie et l’ONU – a placé le désengagement au centre de sa diplomatie de la feuille de route, approuvant effectivement le progrès du ministre du ministre de l’époque, Ariel Sharon, en tant que progrès.
Gaza, février 2025. Auteur: Jaber Jehad Badwan / Source: Wikimedia Commons
La fausse promesse du désengagement
Cependant, la promesse célébrée à l’étranger s’est aigrie à la maison. La télévision israélienne a marqué l’anniversaire de drames et de documentaires qui ont jeté l’évacuation comme un traumatisme national, invitant les téléspectateurs à pleurer avec les familles des colons et à voir les attaques du 7 octobre comme une conséquence inévitable. Ce que ces commémorations ont omis, cependant, était la logique politique de l’époque, qui ne cherchait pas la résolution mais la blocage: enterrer la solution à deux États plutôt que de la faire avancer.
En effet, le mouvement lui-même était une erreur de direction stratégique déguisée en création de paix. En soulignant l’évacuation de quatre avant-postes isolés dans le nord de la Cisjordanie, Sharon pouvait prétendre qu’il n’était pas «Gaza seulement», même s’il a utilisé le geste comme bouclier contre la pression diplomatique croissante. La perte de territoire qui était devenu une responsabilité lui a donné l’espace politique pour resserrer l’emprise d’Israël sur la Cisjordanie. Comme son confident Dov Weisglass l’a admis, le plan était destiné à verser du «formaldéhyde» sur le processus de paix – préservant une impasse tandis que les bulldozers poussaient de nouvelles routes et se logeant plus profondément dans les villes au sommet de la crête.
Les Palestiniens ont rapidement compris ce que les responsables israéliens ont admis ouvertement: Gaza était rejetée comme un signe de flexibilité alors même que l’expansion des règlements en Cisjordanie accélérée. Israël contrôlait toujours le ciel, les mers et les frontières de Gaza – et, avec un effet dévastateur, a tenu un veto sur chaque sac de ciment nécessaire pour reconstruire les maisons, les écoles et les infrastructures après chaque vague de destruction.
La désillusion à la sortie unilatérale n’était pas limitée à Gaza. La retraite d’Israël du sud du Liban en 2000 avait déjà montré à quel point le retrait sans accord risquait de ramener Israël avec plus de force. La peur semblait confirmée en 2006, lorsque l’enlèvement par le Hezbollah de deux soldats a déclenché une guerre, des milliers de roquettes sont tombées sur Israël, la campagne au sol a échoué et une enquête de l’État a marqué au gouvernement des objectifs peu clairs. La leçon que de nombreux Israéliens ont dessinés étaient francs: d’autres retraits, y compris en Cisjordanie, étaient hors de la table.
Pour les Palestiniens, la leçon était le contraire: le militantisme, pas la négociation, pourrait forcer le changement. Israël s’était retiré sans consulter Mahmoud Abbas – ou l’autorité palestinienne – suggérant que la diplomatie n’a rien donné tandis que les roquettes du Hamas ont forcé les concessions. Si les colons ne sont partis que lorsque la violence a rendu l’occupation intenable, le militantisme, et non la négociation, semblait être le levier de l’impact.
Cette croyance a aidé le Hamas à remporter les élections de janvier 2006 et à prendre le contrôle un an plus tard. En réponse, Israël et l’Égypte ont imposé un blocus. Les usines ont rouillé, tandis que les diplômés universitaires de Gaza ont trouvé leurs diplômes inutiles au-delà de la clôture. Pour une génération soulevée sans opportunité, les bulletins de vote semblent futiles tandis que les tunnels et les fusées ont donné des résultats. Pour les faucons à Jérusalem, chaque fusée justifiait le siège; Pour les militants à Gaza, chaque nouvelle restriction a confirmé que la force enregistrée.
Le siège, cependant, n’était pas d’Israël seul – ou d’Israël et d’Égypte d’ailleurs; Au lieu de cela, cela s’est vite durci dans une politique internationale. Les États-Unis et l’Europe ont réduit l’aide directe à l’autorité dirigée par le Hamas et ont limité leur implication aux secours humanitaires. La mission civile d’aide aux frontières de l’UE à Rafah, lancée en 2005, a été suspendue en 2007. Ce qui a commencé comme une impasse régionale durcie dans une politique de confinement.
Même si Gaza a été scellé, la Cisjordanie était refaite. La barrière de séparation s’est glissée à l’extrême est de la ligne d’armistice de 1949 («ligne verte»), en entourant des blocs de colonie. D’ici 2020, le plan de «paix à la prospérité» de l’administration Trump a simplement codifié ce que l’expansion avait déjà établi sur le terrain.
Le cycle du siège et de la guerre
Le siège a été ponctué par les guerres – en 2008-2009, 2012, 2014, 2018 et 2022 – chacune comme une «opération» destinée à rétablir la dissuasion. Les planificateurs l’appelaient «tondre l’herbe», traitant le militantisme comme une tâche récurrente plutôt que le résultat prévisible de l’état sans état. Ce rythme s’est durci dans la doctrine. Chaque tour gauche Gaza plus faible mais jamais silencieuse. D’ici 2023, l’agression du Hamas était moins une rupture qu’un point culminant.
Le 7 octobre 2023, les militants du Hamas ont violé le périmètre de Gaza, attaqué les communautés israéliennes du sud, ont tué environ 1200 personnes et pris 250 otages. Israël a promis de «détruire le Hamas». Après près de deux ans de bombardement et d’incursions, Gaza réside dans les ruines: de vastes zones réduites aux décombres, la plupart de la population déplacée et les décès palestiniens dépassant 60000. Israël encadre la campagne comme une légitime défense existentielle; Les critiques l’appellent une sanction collective, des crimes de guerre et une famine calculée. Une écrasante majorité d’experts affirme que les actions d’Israël dans Gaza équivalent à le génocide: une catastrophe morale qui rappelle les atrocités Europe qui ne se sont pas engagées à ne plus jamais le permettre. Dans une ironie amère, Israël a maintenant autorisé une prise de contrôle militaire complète de Gaza – considérée comme temporaire – exactement vingt ans après avoir déclaré qu’elle avait «quitté» la bande.
Le désengagement a échoué car il n’a jamais été conçu pour réussir – surtout en termes palestiniens. Un véritable retrait aurait transféré la souveraineté avec la responsabilité. Au lieu de cela, Israël a conservé des leviers de contrôle tout en supprimant le devoir pour le bien-être de Gaza. L’unilatéralisme a détruit la réciprocité, affaibli les modérés et autonomisé les extrémistes. Le siège a généré une résistance, pas une soumission – et la sécurité manquant de légitimité s’est avérée creux. Le 7 octobre, ni les murs ni la technologie de surveillance ne pouvaient effacer la proximité ou réprimer le ressentiment.
Les acteurs externes ont aidé à vous retrancher dans l’impasse. Washington et Bruxelles, autrefois couramment la diplomatie à deux États, ont réduit Gaza à une crise humanitaire à gérer, et non un conflit politique à résoudre. Le cessez-le-feu a déplacé les négociations et aide la volonté politique déplacée. En acceptant l’auto-justification d’Israël, les étrangers se sont bercés pour croire que le conflit pourrait être mis en quarantaine.
La tentation de substituer la reconnaissance de la responsabilité est maintenant revenue dans la nouvelle chorégraphie diplomatique d’Europe.
Reconnaissance sans dé-occupation
Alors que Gaza brûle, l’Europe atteint à nouveau les gestes politiques. La France a déclaré qu’elle reconnaîtrait officiellement la Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de septembre, rejointe par le Royaume-Uni, l’Australie, Malte et la Belgique. En parallèle, la France et l’Arabie saoudite ont coprésidé une conférence de haut niveau des Nations Unies qui a produit la «Déclaration de New York», une feuille de route obligée dans le temps promettant des «étapes tangibles, limitées dans le temps» vers deux États. Pourtant, pour l’instant, une grande partie de cette élan reste déclarative.
Le timing cristalle la tragédie. Vingt ans exactement après le «désengagement» de Sharon, alors que les opérations israéliennes se poursuivent à Gaza, les capitales européennes se préparent à reconnaître l’État palestinien. La reconnaissance, l’absence de dé-occupation, les risques devenant une simple cérémonie dans l’ombre de la dévastation – la même logique qui a autrefois échangé le retrait sans souveraineté pour la stabilité d’un siège. La symétrie est indubitable: où Israël a une fois retiré des colons tout en préservant le contrôle, l’Europe offre désormais une reconnaissance tout en acquiesçant au contrôle.
Si la reconnaissance doit être plus que le théâtre, elle doit être de reconnaissance: une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies obligeant l’évacuation du règlement limité et les transferts de terres; restrictions exécutoires liées à la croissance des règlements; transfert des frontières, de l’espace aérien et des ressources à la souveraineté palestinienne; et un soutien solide pour le renouvellement institutionnel palestinien sous un leadership unifié et légitime.
Le désengagement était conçu comme un répit; Au lieu de cela, il a approfondi le désespoir. Deux décennies plus tard, l’avertissement est clair: une crise simplement gérée finira par gérer les États-Unis – et l’Europe, qui a autrefois défendu une solution à deux États, ne peut se permettre de se retirer. La reconnaissance, à elle seule, n’arrêtera pas la dérive. Pour que ce soit, il doit être ancré à des étapes concrètes qui offrent une souveraineté et une réciprocité plutôt que du théâtre. Sinon, l’Europe aura répété deux fois le désengagement: d’abord au nom d’Israël, alors en soi.